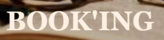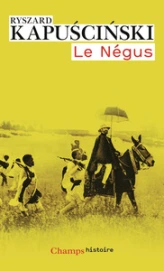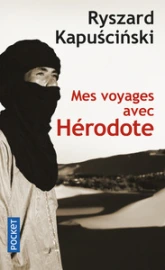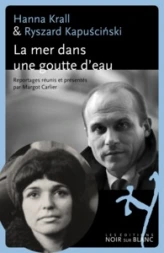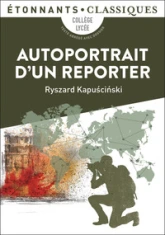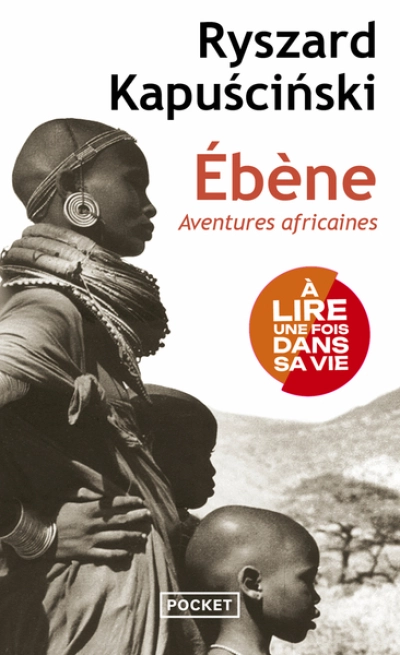
Ebène - Aventures africaines
Résumé éditeur
En stock
l’avis des lecteurs
Dès 1962, Ryszard Kapuściński (1932-2007) travaille pour l'Agence de presse polonaise en tant que correspondant permanent, notamment en Afrique. "Ebène" est une compilation de ses "aventures africaines", ainsi que le précise le sous-titre de l’ouvrage. D’aventures il y est en effet bien question, puisqu’il y relate entre autres son combat contre un puissant cobra, comment il a cru mourir sous des tirs de roquette lors d’une embuscade, puis pris dans une tempête au large du Zanzibar, ou encore la fois où, tombé en panne en plein milieu du désert en compagnie d’un chauffeur peu bricoleur, il s’est demandé si ce dernier allait partager son unique gourde d’eau…
Ces péripéties plus ou moins anecdotiques animent ses récits -en même temps qu’elles forcent l’admiration-, mais sont surtout représentatives de ce qu’est le journalisme selon Ryszard Kapuściński : une immersion totale au cœur de ses sujets, motivée par la quête d’objectivité, une curiosité profondément constructive, et un immense intérêt pour l’autre. Il vit ainsi la plupart du temps parmi les Africains, installé dans des quartiers misérables et parfois réputés dangereux où ne traîne aucun touriste car son objectif est de faire connaissance avec le peuple, de découvrir son mode de vie, sa culture, ses difficultés. En vrai caméléon, il s’adapte à tout, et en retire une grande richesse grâce aux multiples rencontres que lui permet cette immersion.
Ses textes, en balayant plusieurs décennies de reportages, nous emmènent de la fin des années 50 à l’aube des années 2000 et du Sénégal à l’Ethiopie en passant par l’Erythrée, le Ghana, le Nigéria, l’Ouganda, la Somalie, le Mali, le Liberia…
La diversité et la multiplicité de ses voyages démontrent une évidence qu’il énonce d’emblée : "l’africain" n’existe pas en tant qu’entité à part entière. L’Afrique regroupe des centaines d’ethnies et de clans. La notion d'identité est pour la plupart de ses habitants déterminée par le lien avec la famille, le groupe, et non par le village ou la ville où ils sont nés. C’est ainsi que depuis toujours, c'est une terre à l’intérieur de laquelle le mouvement, la migration sont permanents. On retrouve néanmoins au fil des récits certaines constantes, des caractéristiques liées à un héritage culturel ancestral ou aux impératifs d’un environnement naturel hostile qui impose certain mode de vie : l’importance du clan et de la solidarité dont on doit faire preuve en toutes occasions avec ses membres ; l’omniprésence des ancêtres, même morts ; la hantise de la solitude, considérée comme une malédiction, une condamnation ; la vision à la fois existentielle et surnaturelle portée sur les événements, en se convaincant que les tragédies sont liées à l’intervention de forces occultes. La notion même du temps est déterminée par les contraintes extérieures : c’est l’événement qui, lorsqu’il survient, détermine le moment, et non le contraire. On ne prévoit rien, puisque quand on part, on ne sait jamais quand on arrive, et la question n’est jamais de savoir quand on revient, mais si on revient.
L’auteur dépeint la vie quotidienne au sein des villes ou des villages, avec ses rituels et ses contraintes, les règles qui régentent les relations entre les individus. La faim est omniprésente : trouver de quoi boire, se nourrir -généralement une seule fois par jour-, détermine l’organisation des journées. Ses reportages l’amènent tantôt au cœur de vastes étendues vides où règnent la sécheresse -domaine des Touaregs-, tantôt dans le grouillement des villes où déferle en permanence une population en quête de nourriture et de travail, qui meurt passivement de faim et de soif dans des bidonvilles insalubres, faits de bric et de broc.
Le dénuement, la pauvreté, l’instabilité sociale et politique qu’évoquent les textes imprègnent le lecteur avec force.
"Ebène" est un ouvrage très précieux pour comprendre comment et pourquoi l’Afrique s’est engluée dans ce marasme. Ryszard Kapuściński nous explique de manière limpide mais jamais simpliste les enjeux politiques et démontre leurs imbrications avec un héritage historique dont les conflits actuels tirent souvent leurs origines.
Il a assisté aux remous récents de l’histoire africaine, présent au Ghana en 1958 au moment de la conquête de l'indépendance, en Ethiopie lors de la chute de l’empire d’Hailé Sélassié, au Zanzibar au moment de la révolution qui met fin à 200 ans de domination d’élite arabophone. Il était à Lagos en 1966 lors du putsch militaire qui a conduit à l’assassinat de masse de figures politiques… Des années 1970 aux années 1990, il couvre guerres civiles, révoltes, coups d'état, massacres et famines. Il croise des anonymes et des dictateurs : Amin Dada en Ouganda, Samuel Doe au Liberia… Il tient une conférence sur la genèse du génocide rwandais.
Il lie les événements dont il est le témoin au contexte, présent et passé, qui les a engendrés, en insistant notamment sur les plaies qu’ont laissées l’esclavage et la colonisation sur l’Afrique, qui ne s'est toujours pas relevée de ces calamités. Ce continent, où s’étaient déjà imposés les religions d’occupants -catholiques ou musulmans- qui ont appauvri une culture indigène basée sur l’oralité, a ensuite été vidé par les trafiquants d'esclaves, le condamnant à une vie végétative. Aujourd'hui encore, de nombreux territoires sont dépeuplés, transformés en désert. Mais les conséquences de cet asservissement sont également psychologiques, à l'origine d'un complexe d'infériorité dont les Africains ont du mal à se défaire, ayant empoisonné les relations humaines, semé la haine et la guerre.
"De l'Afrique, l'européen ne voit que l'enveloppe extérieure, une partie, peut-être la moins intéressante et la moins importante. (…) Le drame de nos civilisations, et de l'Europe notamment, c'est que jadis les premiers contacts avec l'Afrique ont été le privilège d'individus de la pire engeance. (…) Les relations humaines ont été fixées d'après le critère le plus primitif : celui de la couleur de peau. Le racisme est devenu une idéologie selon laquelle l'homme définissait sa place dans l'ordre mondial. (…) Le racisme, la haine de l'autre, le mépris et le désir d'extermination trouvent leurs racines dans les relations coloniales en Afrique. C'est là-bas que tout a été inventé et mis en pratique, bien des siècles avant que les systèmes totalitaires ne viennent greffer leurs expériences lugubres et honteuses sur l'Europe du 20e siècle."
Avec la décolonisation, les africains ont cru qu’ils accéderaient à la liberté et à une vie confortable. Or, le terrain sur lequel les indépendances ont pris pied était miné, et ce n'est pas ce qui s'est passé. Dans un contexte de guerre froide, l'est et l'ouest ont ignoré les problèmes et les affaires des pays faibles et dépendants, les gérant seulement selon leurs propres intérêts, avec leur supériorité et leur arrogance ethnocentriques d’occidentaux.
La décolonisation a ravivé d'anciennes relations interethniques, un réseau complexe d'antagonismes et de ressentiments que le pouvoir étranger avait ignoré, allant jusqu’à imposer comme condition à l’indépendance que les ennemis d'hier s’associent. L'espoir des années 50 et 60 des pays enfin libérés du joug colonial a ainsi fait place à des luttes acharnées pour le pouvoir, aux conflits tribaux et ethniques, à la corruption et aux assassinats. À l'image de la frénésie et de la précipitation avec laquelle tout se fait au 20e siècle, il a suffi de quelques jours pour qu’émerge alors une classe gouvernante de nouveaux riches, qui se sont empressés de se remplir les poches. On est passé de l'optimisme à une amère désillusion ainsi qu’à une haine tournée vers les élites régnantes et une atmosphère propice aux révoltes et aux coups d’état, les armes automatiques apportées -avec plus d’empressement que l’électricité ou les infrastructures- par la civilisation moderne décuplant alors le nombre de victimes.
C’est ainsi qu’au cours du XXème siècle, une majorité de noirs a péri de la main de noirs.
A cela s’est ajouté le fléau de la sécheresse qui s'est abattue sur le continent dans les années 70 puis 80, brûlant les champs, décimant le bétail. Des millions d’africains sont morts de faim pendant que des millions d'autres allaient chercher le salut dans les villes où était distribué une aide internationale que l’inaccessibilité des villages empêchait d’arriver jusqu’aux campagnes.
Un bilan post-colonial bien désespérant, d’autant plus que l’Afrique a perdu la plupart de ses intellectuels, partis vivre à l'étranger, amoindrissant encore les opportunités pour ce continent de se développer, et a fortiori de participer aux grandes mutations mondiales.
Pour autant, la note sur laquelle Ryszard Kapuściński clôt son recueil n’est pas désespérée : en donnant la parole à de nouvelles voix, celles justement de certains de ces intellectuels que compte dorénavant l’Afrique, convaincus que l’instruction est l’enjeu primordial de l’Afrique puisqu’elle permettra entre autres de lutter contre un aveuglement ethnique qui ne peut qu’entraver son développement, il sous-entend, même si la route est longue, la possibilité de lendemains meilleurs…
Un ouvrage essentiel, passionnant et humaniste.
"L'Afrique a toujours été perçue, et elle continue de l'être, comme un objet, comme le reflet d'une autre étoile, comme un terrain d'action pour les colonisateurs, les marchands, les missionnaires, les ethnographes, toutes sortes d'organisations caritatives. Néanmoins elle existe, en dépit de tout, pour elle-même, en elle-même : continent éternel, fermé et isolé, terre de bananeraies, de petits champs irréguliers de manioc, jungle, Sahara immense, fleuves qui se dessèchent lentement, forêts qui s'éclaircissent, villes malades et monstrueuses, espace chargé d'une électricité nerveuse et violente."

Livraison soignée
Nos colis sont emballés avec soin pour des livres en excellent état

Conseil de libraires
et des sélections personnalisées pour les lecteurs du monde entier

1 millions de livres
romans, livres pour enfants, essais, BD, mangas, guides de voyages...

Paiement sécurisé
Les paiements sur notre site sont 100% sécurisés