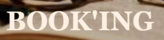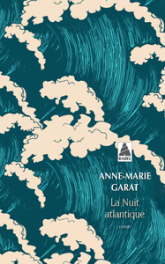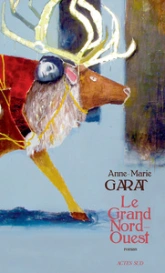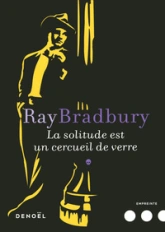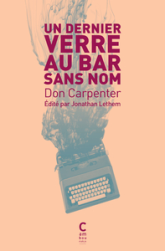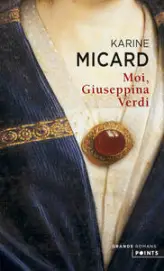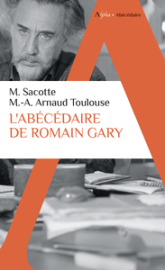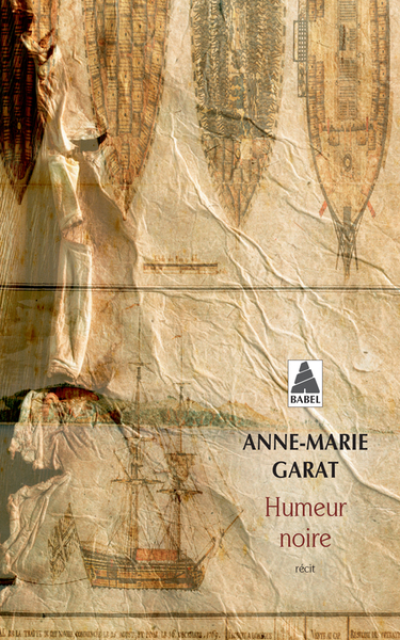
Humeur noire
Résumé éditeur
livré en 5 jours
livré en 5 jours
l’avis des lecteurs
Anne-Marie Garat est bordelaise mais entretient avec sa ville natale une relation conflictuelle, caractérisée par un rejet qui l’en tient la plupart du temps éloignée (elle vit dorénavant à Paris). C’est à l’occasion de la trouvaille accidentelle d’un album de famille par un de ses cousins, initiant des échanges sur le passé d’un aïeul, qu’elle y revient, sur une même période, à plusieurs reprises.
Lors d’un de ses séjours, elle visite le Musée d’Aquitaine, et tombe en arrêt devant un écriteau de l’exposition, récemment mise à jour, sur la traite négrière. Encadré de deux tableaux illustrant la vie de bourgeois bordelais du XVIIIème siècle sur lesquels figurent une nourrice noire et un négrillon enturbanné portant un collier de servage au cou, il est porteur d’un texte dont le vocabulaire inapproprié la met en rage, qui par un choquant euphémisme présente la condition des noirs vivant alors à Bordeaux comme un état enviable.
La lettre qu’elle écrit au conservateur du musée, puis la tribune qu’elle publie dans Le Monde, co-signée par de nombreux artistes, sont sans effet. La colère qui en résulte, alimentée par un sentiment de vérité trahie auquel s’ajoute les griefs accumulés contre sa ville de naissance, est à l’origine de l’écriture "d’Humeur noire".
Elle s’y livre à une entreprise de réhabilitation de la réalité niée par le cartel du musée, et y mêle des souvenirs d’enfance ou de jeunesse qui pourraient passer pour des digressions, mais qui lui permettent en réalité non seulement d’élargir mais aussi d’étayer son propos.
Elle rappelle l’évidence occultée par la note explicative du musée : les noirs présents à Bordeaux de 1730 à la fin du XVIIIème siècle sont de la première génération des déportés d’Afrique ou leurs enfants, donc forcément porteurs du traumatisme de la capture, de la mémoire des traversées cauchemardesques, du marquage au fer rouge, de l’arrachement aux mères, de la négation, enfin, de leur identité… elle rétablit la réalité de leur statut : celui d’esclaves subissant un joug exercé avec despotisme et mépris, et non, comme le laisse entendre le cartel, celui de privilégiés venus en Europe pour se former, vivant en "bonne cohabitation" avec une population blanche bienveillante et hospitalière…
Elle s’attarde sur les infâmes mécanismes à l’œuvre, sur l’intention -fuite, déni- que révèle cette minimisation de la condition noire, cet "oubli" de la replacer dans un contexte, celui d’un temps où les grandes familles bordelaises purent asseoir et développer leur fortune grâce au commerce en droiture, directement pratiqué avec les colonies d’Amérique : les négociants européens vendent alors aux colonies des productions agricoles et des produits manufacturés ou matières premières venus de l'arrière-pays bordelais (viande, du vin, tissus…) et ces mêmes négociants ramènent des Antilles de l’indigo, du café, du sucre, du cacao, revendus très chers en Europe. Ce qui a longtemps constitué pour Bordeaux un argument lui permettant de minimiser son rôle dans le commerce triangulaire, au grand dam de l’auteure, très virulente envers la capacité à l’amnésie ou à l’autojustification de sa ville natale vis-à-vis d’une Histoire faite de compromissions. Et elle évoque, au-delà de ce passé esclavagiste relégué aux oubliettes, l’adhésion enthousiaste de la ville à Vichy, et les alliances ou cohabitations faisant après la guerre siéger aux mêmes instances et se croiser dans les mêmes couloirs résistants et collabos.
C’est peu de dire qu’Anne-Marie Garat n’est pas tendre avec cette commune où elle a grandi, envers laquelle elle nourrit par ailleurs des reproches plus personnels, exprimés à l’occasion de bribes de souvenirs remontant à son enfance puis à ses années étudiantes. D’extraction modeste, elle est née et a vécu au cœur du quartier ouvrier des Chartrons (aujourd’hui en pleine gentrification), et a dû affronter, au lycée puis en accédant aux études supérieures, la condescendance de camarades pour la plupart issus de la bourgeoisie bordelaise. On s’intéresse au passage à ce parcours de jeune prolétaire tombée précocement dans l’amour de l’art -plus particulièrement la littérature et le cinéma-, déterminée à échapper au déterminisme social, malgré la difficulté supplémentaire que constitue son statut de fille. Elle devra pour cela lutter aussi contre les préjugés paternels, qui estime qu’être institutrice est le summum de ce à quoi elle peut prétendre : pourquoi s’entêter à vouloir faire carrière dans les arts, qui on le sait sont un repère de feignants, de débauchés et de fils à papa ?
Tout cela est sans rapport avec le cartel du musée d’Aquitaine ? Détrompez-vous ! Car si Anne-Marie Garat fustige l’arrangement que le cartel conclue avec la vérité, elle n’est pas moins sévère envers le mépris qu’il suppose envers ses lecteurs, qui traduit celui plus général que les milieux académiques et bourgeois affichent envers le peuple (et auquel, on vient de le voir, elle a été confrontée).
En amoureuse du langage, elle en défend avec virulence l’importance, exprimant sa détestation de ses usages inconséquents -car oui, "les mots tuent"-, rappelant la responsabilité de celui qui écrit à destination d’un public. En tant qu’enseignante, mais aussi en tant qu’auteure qui revendique l’importance d’écrire en toute indépendance (notamment financière, raison pour laquelle elle continue d’exercer son métier), elle prône la nécessité de donner l’usage du langage (insistant sur son pouvoir politique et social) aux enfants et futurs citoyens qu’ils deviendront, et égratigne au passage un enseignement qui contrecarre ce projet en faisant des professeurs des mécaniciens de la langue, des techniciens dévitalisant la puissance de l’art en le réduisant à un ensemble de mécaniques, de figures de rhétoriques ou de narratologie au dépens de l’imagination, du "transport" que doit apporter la littérature.
Ainsi, priver l’individu du matériau que représente un témoignage éclairé et honnête sur le contexte historique, social et politique qui en partie le constitue, revient à lui enlever la possibilité d'acquérir cette présence à soi-même et à son histoire que permet l'appropriation du langage, notamment par l’intermédiaire des littératures, du cinéma, bref, de la culture et des arts en général.
Il y aurait encore beaucoup à dire sur ce passionnant essai (qui mérite plusieurs lectures) que nous livre Anne-Marie Garat, professeure militante, écrivaine engagée et citoyenne révoltée… je m’arrête là pour ma part, espérant vous avoir convaincus.

Livraison soignée
Nos colis sont emballés avec soin pour des livres en excellent état

Conseil de libraires
et des sélections personnalisées pour les lecteurs du monde entier

1 millions de livres
romans, livres pour enfants, essais, BD, mangas, guides de voyages...

Paiement sécurisé
Les paiements sur notre site sont 100% sécurisés